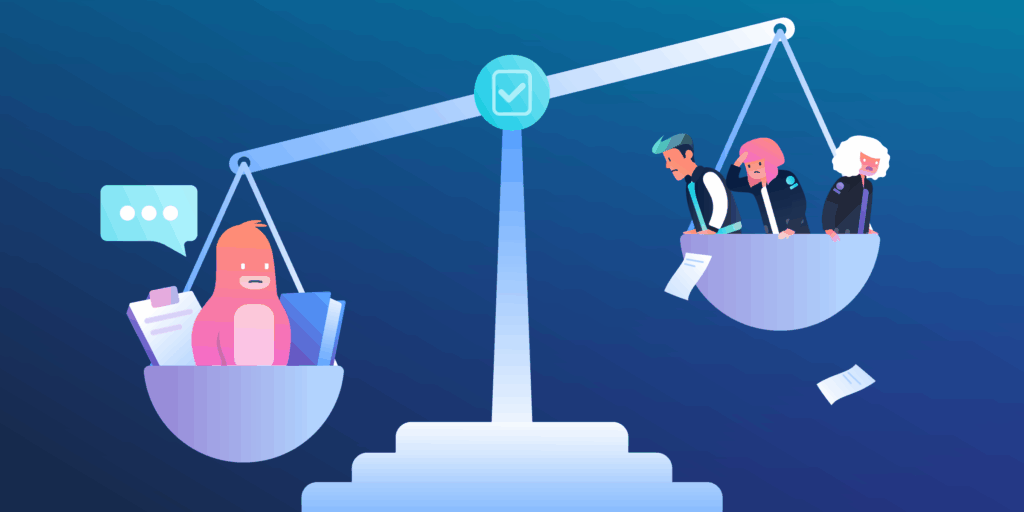
On entend souvent ce proverbe comme une invocation à l’harmonie, une sorte de leçon universelle : oublie ta vitesse solo, rejoins le groupe et on ira ensemble au bout du monde. C’est séduisant. C’est aussi trompeur.
Car la vraie question n’est pas d’opposer la vitesse du « je » à la puissance du « nous ». C’est de comprendre que ces deux forces ne jouent pas le même rôle selon où en est votre organisation. Et que confondre les phases de développement coûte cher : en énergie, en talent perdu, et en capacité d’adaptation.
Le piège de la théorie universelle
On vend beaucoup de sagesse managériale standardisée. Le « collectif est toujours la solution ». L’agilité est un dogme. La transformation digitale attend votre adhésion immédiate. Mais une entreprise en phase pionnière n’a pas les mêmes besoins qu’une entreprise en croissance structurée. Et exiger du collectif quand il faut de la vitesse, c’est étouffer ce qui doit émerger.
Inversement, garder une hyper-individualisation une fois qu’on scale, c’est fragiliser l’organisation. On voit les signes : des départs difficilement remplaçables, parce que le savoir repose sur trop peu de personnes. Des goulots d’étranglement impossibles à contourner. Une fragilité invisible jusqu’au jour où elle paralyse.
La phase pionnière : l’individu comme moteur
Quand on démarre, de 0 à 1, la question centrale est simple : comment transformer une idée en réalité ? Comment passer du rêve au produit, du concept au service qui fonctionne vraiment ?
C’est ici que l’hyper-individualisation fait sens. Pas l’individualisme, attention. Il y a une différence. L’hyper-individualisation, c’est reconnaître qu’une poignée de talents exceptionnels, complémentaires, spécialisés dans leur fonction, sont le moteur de cette création. Entre deux et quatre co-fondateurs généralement. Chacun incarne une fonction essentielle, chacun apporte sa singularité. Et cette singularité n’est pas du luxe, c’est le carburant.
Pourquoi ? Parce qu’on ne peut pas démocratiser la phase 0 à 1. On ne peut pas décider en comité que la vision doit être collective quand ce qui compte, c’est la capacité à simplifier, à trancher, à créer rapidement. Le collectif au stade pion nier paralyse souvent autant qu’il n’accélère. On passe le temps à aligner, à convaincre, à construire du consensus sur des choses qui n’existent pas encore.
Les fondateurs sont reconnus pour leur singularité. Ce n’est pas de l’ego. C’est une condition d’efficacité.
Le basculement invisible : quand l’organisation change
Mais il y a un moment. Un moment où la logique change. Pas brutalement. Progressivement. Quand l’organisation passe de 10 à 50, de 50 à 200 personnes. Quand on ne peut plus tout faire reposer sur trois cerveaux. Quand il faut documenter, partager, déléguer sans que tout s’écroule.
Le dirigeant doit « sentir » ce moment. Il n’y a pas de formule magique. Mais les signes existent. Quand les départs deviennent difficilement remplaçables… c’est peut-être que le collectif devient urgent.
C’est là que la sécurité devient un enjeu. La scalabilité devient un enjeu. Vous ne pouvez plus compter sur la virtuosité de trois héros. Vous devez construire une organisation qui marche sans eux. Et pour ça, il faut du collectif. Des processus, des apprentissages partagés, une documentation vivante, une culture qui transcende les individus.
Le collectif sans dilution : maintenir la singularité
Voilà le vrai défi. Et c’est peut-être la question centrale que se pose 1Clusif en questionnant des entrepreneurs : comment scale-t-on en préservant ce qui fait la force d’une organisation ? Comment maintenir la reconnaissance de la singularité de chacun quand on passe à 100, 500, 1000 personnes ?
Parce que ici est le piège du collectif mal pensé : noyer les gens dans la masse. Leur faire croire qu’ils ne sont qu’une fonction interchangeable. Et vous savez ce qui se passe alors ? L’épanouissement s’éteint. Et avec lui, l’engagement.
Un individu noyé dans le collectif n’a que peu de chances de s’épanouir. Et un individu qui ne s’épanouit pas ne peut pas s’investir vraiment dans la mission. Il survit. Il ne vit pas son travail.
L’épanouissement vient d’ailleurs. Il vient quand votre fonction est vraiment utile au collectif, quand cette utilité est reconnue, et quand votre singularité est vue et valorisée. Pas effacée. Pas dilués dans un « nous » uniforme. Intégrée, oui. Célébrée, même.
Chez 1Clusif, on porte la conviction que on ne construit pas du collectif en effaçant les singularités. On le construit en valorisant chaque individu ET en créant des liens forts. C’est la tension entre « je » et « nous » qui crée quelque chose d’utile.
Les tensions comme force créatrice
D’ailleurs, parlons des tensions. Car il n’y a pas d’organisation sans tensions. Entre ceux qui veulent avancer vite et ceux qui veulent consolider. Entre l’innovation et la stabilité. Entre l’ambition d’un individu et les besoins du collectif.
Ces tensions existent. Elles existeront toujours. Elles ne sont pas un symptôme de dysfonctionnement. Elles sont le signe qu’il y a de la vie, de la diversité, de la créativité potentielle.
La question n’est donc pas : comment les éliminer ? Mais : comment les canaliser ? Comment les transformer en force créatrice plutôt qu’en paralysie ?
C’est là que le leadership adaptatif compte vraiment. C’est là qu’on voit si une organisation peut vraiment apprendre et évoluer. Sans gommer les différences, sans forcer un consensus artificiel, mais en créant les conditions où les tensions deviennent des conversations, et où les conversations deviennent de vraies transformations.
L’invariant : la responsabilité
Si je dois retenir une seule constante dans tout ça, c’est celle-ci : peu importe la phase, il y a une valeur qui ne négocie pas. C’est la responsabilité. Elle change de forme selon le contexte, mais elle reste.
Dans la phase pionnière, la responsabilité du fondateur est d’agir, de décider, de créer. De porter la singularité de la vision et d’en assumer les conséquences. C’est personnel. C’est incarné.
Dans la phase de croissance, la responsabilité se distribue. Chacun devient responsable de sa zone, de ses décisions, de l’impact sur le collectif. Ce n’est plus l’hyper-concentration du pouvoir. Mais c’est plus de responsabilité partagée. Et c’est beaucoup plus exigeant pour chacun.
C’est une des valeurs fondatrices de 1Clusif : la responsabilité. Non pas comme une menace ou un contrôle. Mais comme l’honneur d’être parte prenante de quelque chose qui compte. D’assumer ses décisions et leurs conséquences. De contribuer vraiment.
Conclusion : l’équilibre n’est pas un état
Donc non, la question n’est pas « tout seul vs ensemble ». C’est : comment adapter l’équilibre entre singularité et collectif à la réalité vivante de mon organisation ?
Cela demande une certaine lucidité. De se demander régulièrement : où en sommes-nous vraiment ? Avons-nous les bons individus au bon endroit ? Qu’est-ce qui nous ralentit : trop d’individualisme ou pas assez de collectif ?
Et cela demande une autre chose : de l’authenticité. D’arrêter de vendre des solutions universelles et de commencer à vraiment regarder ce qui fonctionne dans votre contexte, avec votre équipe, face aux défis que nous affrontons.
C’est dans cet esprit que 1Clusif travaille avec les entrepreneurs : en cherchant ensemble les invariants, les principes qui tiennent, les expériences qui créent du vrai collectif adaptable.
Ni la vitesse du solo, ni l’immobilisme du groupe. Mais le rythme juste, au bon moment, avec les bonnes personnes.
Rédigé par Jérôme Savajols
