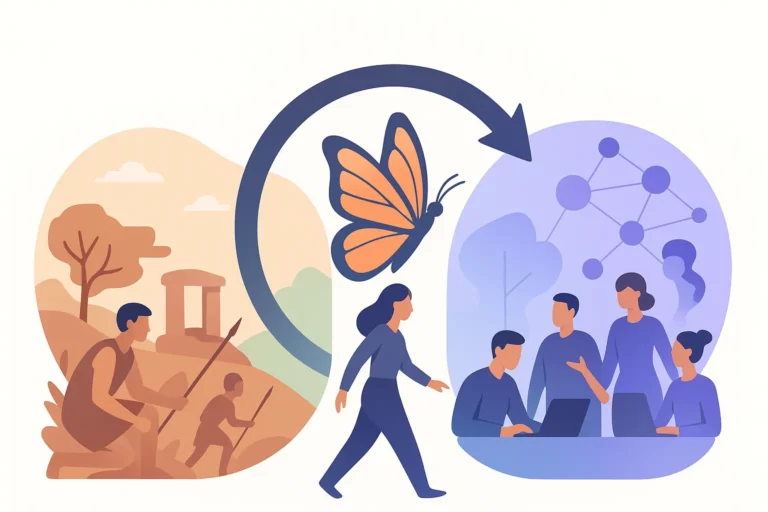
L’adaptation à travers les âges : un coefficient de survie pour nos organisations
Dans un monde qui change plus vite que jamais, une question traverse les millénaires : comment les sociétés humaines survivent-elles aux bouleversements ? Face au dérèglement climatique, aux incertitudes économiques, aux tensions géopolitiques et aux bouleversements technologiques, nous sommes confrontés à un choix ancestral : résister ou s’adapter. L’histoire des civilisations nous enseigne que ce n’est pas la force qui garantit la survie, mais la capacité à transformer ses pratiques face à l’imprévu.
La longue histoire de l’adaptation humaine
Depuis les origines de l’humanité, l’adaptation a été notre force principale. Lorsque nos ancêtres chasseurs-cueilleurs ont progressivement domestiqué les plantes et les animaux il y a environ 10 000 ans, ils ne savaient pas qu’ils amorçaient l’une des plus grandes transformations de l’histoire humaine. Cette révolution néolithique n’était pas une rupture brutale, mais une série d’adaptations progressives aux changements climatiques et à la raréfaction du gibier.
Les sociétés humaines ont développé d’innombrables stratégies adaptatives face à la variabilité naturelle du climat. Elles ont su s’implanter dans pratiquement toutes les zones climatiques du globe, y compris les plus extrêmes. Cette plasticité remarquable n’est pas le fruit du hasard : elle résulte d’une capacité à observer, expérimenter et transmettre les apprentissages d’une génération à l’autre. C’est précisément cette valeur de transmission que 1Clusif place au cœur de son action.
Quand l’adaptation échoue : les leçons de l’effondrement
L’histoire n’est pas qu’une succession de réussites. Elle est aussi jalonnée d’effondrements qui nous interrogent. Le géographe Jared Diamond, dans son ouvrage marquant Effondrement, a analysé les causes de la disparition de plusieurs sociétés anciennes. Ses conclusions sont éclairantes pour nos organisations contemporaines.
L’île de Pâques : quand l’exploitation dépasse la régénération
L’île de Pâques offre l’exemple le plus frappant d’une société qui a détruit involontairement les ressources dont elle dépendait. Pour ériger et transporter leurs monumentales statues de pierre, les habitants ont progressivement déboisé l’île entière. Cette déforestation a entraîné une cascade de bouleversements écologiques : érosion des sols, diminution des rendements agricoles, disparition des ressources marines. La population, estimée à 15 000 habitants à son apogée, s’est effondrée jusqu’à environ 2 000 personnes, plongeant dans des guerres civiles destructrices.
Le paradoxe troublant : les habitants ont probablement coupé le dernier arbre en sachant pertinemment qu’il était le dernier. Pourquoi ? Parce que les structures sociales, les valeurs religieuses et les intérêts à court terme des élites ont empêché toute remise en question. C’est cette rigidité culturelle qui a condamné la société, pas l’épuisement des ressources en soi.
Les Vikings du Groenland : le piège du conservatisme culturel
L’histoire des Vikings du Groenland illustre de manière encore plus saisissante les dangers du refus d’adaptation. Arrivés vers l’an 1000 lors d’une période climatique favorable, ces colons norvégiens ont tenté de reproduire leur mode de vie européen dans un environnement radicalement différent.
Pendant cinq siècles, ils ont maintenu leurs pratiques d’élevage bovin, symbole de prestige dans leur culture d’origine, malgré un climat de plus en plus hostile. Ils ont ignoré les techniques de chasse et de pêche des Inuits, population locale parfaitement adaptée au milieu arctique. Ils ont préféré importer des ornements religieux et des bijoux plutôt que des ressources vitales. Ce mépris pour les solutions locales et cet attachement aux valeurs d’origine les ont conduits à l’extinction complète de leur colonie vers 1450.
À quelques kilomètres de là, les Inuits ont prospéré. Même territoire, même climat, issue radicalement différente. La variable décisive ? La flexibilité culturelle et la capacité à ajuster ses pratiques.
Les facteurs d’effondrement selon Diamond
Jared Diamond identifie cinq facteurs combinés qui peuvent mener une société à l’effondrement :
- Les dommages environnementaux causés souvent involontairement
- Les changements climatiques qui bouleversent les conditions de base
- Les voisins hostiles qui exercent une pression externe
- La perte de partenaires commerciaux essentiels
- Les réponses inadaptées de la société, selon ses valeurs propres
Ce dernier facteur est crucial. Ce n’est pas l’environnement qui détermine l’effondrement, mais la capacité – ou l’incapacité – d’une société à transformer ses pratiques face aux bouleversements. L’effondrement n’est jamais une fatalité : c’est un choix, conscient ou non.
Les sociétés qui ont su s’adapter
Heureusement, l’histoire ne se résume pas aux catastrophes. Certaines sociétés ont démontré une remarquable capacité d’adaptation face à des défis similaires.
Le Japon de l’ère Tokugawa : l’adaptation par la régulation
Le Japon du XVIIe au XIXe siècle offre un exemple fascinant de société qui a su anticiper et gérer une crise écologique majeure. Face à une déforestation massive qui menaçait l’approvisionnement en bois de construction et en combustible, le shogunat Tokugawa a mis en place dès 1666 des politiques de gestion forestière parmi les plus sophistiquées de l’époque.
Ces mesures comprenaient la plantation systématique d’arbres, la rotation des coupes, la protection de certaines zones forestières et des règlements stricts sur l’utilisation du bois. Parallèlement, la société s’est adaptée en développant des techniques de construction économes en bois et en recyclant systématiquement les matériaux.
Plus remarquable encore, le Japon a maintenu une population stable autour de 30 millions d’habitants pendant plus d’un siècle, évitant ainsi la surpopulation qui aurait aggravé la pression sur les ressources. Cette stabilisation démographique n’était pas imposée par le haut, mais résultait d’un consensus social sur la nécessité de vivre dans les limites de l’environnement.
La transformation radicale : Meiji et l’ouverture au monde
Après plus de deux siècles d’isolement volontaire (sakoku), le Japon a opéré au milieu du XIXe siècle l’une des transformations les plus spectaculaires de l’histoire. Face à la pression occidentale symbolisée par l’arrivée du commodore Perry en 1853, le pays a fait un choix radical : plutôt que de résister par la force à la modernité industrielle, il allait l’adopter et l’adapter.
L’ère Meiji (1868-1912) a vu le Japon basculer en quelques décennies d’un système féodal vers une puissance industrielle moderne. Cette transformation n’était pas une simple imitation de l’Occident, mais une synthèse créative : adoption des technologies et méthodes organisationnelles occidentales tout en préservant et réinventant les valeurs culturelles japonaises.
Ce qui rend cette adaptation encore plus remarquable, c’est qu’elle s’est appuyée sur des structures existantes. Le confucianisme, qui prônait la hiérarchie et le respect de l’autorité, a été réinterprété pour servir la modernisation. Les marchands, traditionnellement méprisés dans la hiérarchie sociale, sont devenus les moteurs du développement économique. Les samouraïs se sont reconvertis en officiers, ingénieurs et entrepreneurs.
Cette capacité à transformer sans détruire, à moderniser en préservant l’identité, illustre un coefficient d’adaptation particulièrement élevé. Le Japon a compris qu’il ne s’agissait pas de choisir entre tradition et modernité, mais de créer une nouvelle synthèse.
Qu’est-ce qui favorise l’adaptation ? Une question de culture organisationnelle
Si certaines sociétés s’adaptent mieux que d’autres, c’est rarement une question de moyens matériels ou de compétences techniques. C’est fondamentalement une question de culture : les valeurs, les croyances, les structures de pouvoir et les modes de décision qui façonnent une organisation.
Les freins culturels à l’adaptation
Plusieurs facteurs culturels peuvent bloquer l’adaptation :
- Le conservatisme des valeurs : Lorsqu’une pratique est sacralisée ou liée à l’identité du groupe, la remettre en question devient psychologiquement et socialement impossible. Les Vikings du Groenland ne pouvaient abandonner l’élevage bovin sans renoncer à ce qu’ils considéraient comme leur essence norvégienne.
- La capture cognitive des élites : Lorsque ceux qui décident sont isolés des conséquences de leurs choix, ils peuvent maintenir des pratiques destructrices. Sur l’île de Pâques, les chefs et les prêtres qui ordonnaient la construction des statues ne travaillaient pas directement dans les champs appauvris.
- Le déni collectif : Face à une menace complexe et progressive, les sociétés peuvent minimiser ou ignorer les signaux d’alarme, surtout lorsque ces signaux remettent en question le modèle dominant. Notre propre rapport au changement climatique en est un exemple contemporain.
- Les conflits d’intérêts à court terme : Même lorsque la nécessité d’adaptation est reconnue, les intérêts immédiats de certains groupes peuvent bloquer les transformations nécessaires. Qui accepte de perdre des privilèges aujourd’hui pour le bien commun de demain ?
Les facilitateurs culturels de l’adaptation
À l’inverse, certaines cultures organisationnelles favorisent l’adaptation :
- L’expérimentation tolérée : Les sociétés qui permettent l’essai-erreur, qui ne sanctionnent pas l’échec mais l’apprentissage, développent une capacité d’innovation plus grande. C’est ce que les gouvernances humanistes cherchent à instaurer dans les organisations modernes.
- La diversité des perspectives : Lorsqu’une organisation valorise la pluralité des points de vue et permet à différentes voix de s’exprimer, elle détecte plus rapidement les signaux faibles et imagine des solutions plus créatives. L’homogénéité rassure, mais la diversité adapte.
- La transmission des savoirs : Les sociétés qui documentent leurs expériences, qui transmettent leurs apprentissages et qui étudient leur propre histoire évitent de répéter les mêmes erreurs. Cette mémoire organisationnelle est un atout précieux.
- La capacité à désacraliser les pratiques : Les organisations les plus résilientes distinguent ce qui est essentiel (leurs valeurs profondes) de ce qui est contingent (leurs méthodes). Elles savent préserver le premier tout en adaptant constamment le second.
- Le leadership par l’exemple : Lorsque les dirigeants incarnent eux-mêmes la capacité à se remettre en question, à apprendre et à évoluer, ils autorisent toute l’organisation à faire de même.
Le coefficient d’adaptation : un outil pour penser nos organisations
Chez 1Clusif, nous développons le concept de coefficient d’adaptation pour évaluer la capacité d’une organisation à faire face aux bouleversements. Ce coefficient n’est pas une mesure absolue, mais un cadre de réflexion qui nous aide à identifier les leviers et les blocages.
Comment évaluer le coefficient d’adaptation d’une organisation ?
Plusieurs dimensions entrent en jeu :
- La vitesse de détection des signaux : À quelle rapidité l’organisation repère-t-elle les changements dans son environnement ? Dispose-t-elle de mécanismes d’écoute et de veille efficaces ?
- La diversité des réponses possibles : Face à un problème, l’organisation envisage-t-elle plusieurs solutions, ou se cantonne-t-elle à ses recettes habituelles ? Le répertoire d’action est-il riche ou limité ?
- La capacité à expérimenter : L’organisation teste-t-elle ses hypothèses à petite échelle avant de généraliser ? Accepte-t-elle l’échec comme source d’apprentissage ? C’est l’essence même des méthodes agiles.
- La répartition du pouvoir de décision : Les décisions d’adaptation peuvent-elles émerger à tous les niveaux, ou sont-elles monopolisées par une élite ? Plus le pouvoir est distribué, plus l’adaptation peut être rapide et contextualisée.
- La force du collectif : L’organisation fonctionne-t-elle comme un ensemble d’individus juxtaposés, ou comme un véritable collectif capable d’intelligence collective ? Existe-t-il un sentiment d’appartenance qui transcende les intérêts particuliers ?
- L’équilibre entre stabilité et mouvement : Une organisation trop stable se rigidifie ; une organisation trop mouvante se disperse. Le coefficient d’adaptation optimal combine des valeurs stables avec des pratiques flexibles.
Le paradoxe fondamental : l’individu dans le collectif
Un des enseignements les plus profonds de l’histoire de l’adaptation concerne la tension entre l’individu et le collectif. Les sociétés qui ont survécu ne sont ni celles qui ont dissous l’individu dans le groupe, ni celles qui ont exalté l’individualisme au point de détruire tout lien social.
Comme l’exprime la philosophie de 1Clusif : « Pour accepter d’être dilués dans un collectif, nous avons besoin d’affirmer notre singularité et nous avons besoin que cette singularité soit reconnue par le groupe. »
C’est précisément cet équilibre que le Japon de l’ère Meiji a réussi : maintenir une forte cohésion collective tout en libérant l’initiative individuelle. Les entrepreneurs ont pu innover dans un cadre collectif qui donnait sens à leur action. La modernisation n’était pas vécue comme une trahison de l’identité, mais comme son accomplissement dans des conditions nouvelles.
Dans nos organisations contemporaines, cet équilibre est plus que jamais crucial. Face aux défis que nous affrontons, nous ne pouvons compter uniquement sur des directives venues du sommet, pas plus que sur des initiatives individuelles déconnectées. Nous avons besoin de collectifs adaptables où chaque membre se sent à la fois reconnu dans sa singularité et engagé dans une œuvre commune.
Résister ou s’adapter ? Un faux dilemme
Face aux enjeux actuels – dérèglement climatique, incertitudes économiques, tensions géopolitiques, bouleversements technologiques – il serait tentant de poser un choix binaire : faut-il résister ou s’adapter ?
L’histoire nous enseigne que cette opposition est trompeuse. Toute adaptation réussie contient une part de résistance : résistance au renoncement, à la perte d’identité, à l’oubli de ce qui fait notre humanité. Les Vikings du Groenland auraient dû résister à la tentation de la reproduction servile de leur modèle norvégien. Le Japon Meiji a résisté à la dissolution de son identité dans la copie pure de l’Occident.
Inversement, toute résistance viable nécessite de l’adaptation. On ne défend pas efficacement ce qui nous est cher en restant figé dans des formes dépassées. On le défend en le réinventant, en le traduisant dans le contexte nouveau.
Le véritable enjeu n’est donc pas de choisir entre résistance et adaptation, mais de discerner ce à quoi nous devons résister et ce à quoi nous devons nous adapter. Résister dans nos valeurs fondamentales – l’égalité par nature, la transmission, la responsabilité, l’esprit entrepreneurial, la créativité qui animent 1Clusif. S’adapter dans nos méthodes, nos structures, nos pratiques organisationnelles.
Que nous disent ces leçons pour nos organisations d’aujourd’hui ?
L’accélération contemporaine rend l’adaptation plus urgente et plus complexe. Nous ne disposons plus de générations pour transformer nos pratiques. Les bouleversements se superposent et interagissent d’une manière inédite. Le changement climatique apporte une dimension nouvelle : nous devons nous adapter aux conséquences de nos propres actions tout en les modifiant.
Pourtant, les principes fondamentaux demeurent :
- L’adaptation n’est pas une option, c’est une condition de survie. Nos organisations, comme les civilisations qui nous ont précédés, n’ont d’autre choix que de transformer leurs pratiques face à un environnement qui change.
- La rigidité culturelle est plus mortelle que la contrainte environnementale. Ce ne sont pas les défis objectifs qui déterminent notre destin, mais notre capacité collective à les affronter avec intelligence et créativité.
- L’adaptation n’est pas un processus technique, mais culturel. Elle exige de remettre en question nos certitudes, d’expérimenter de nouvelles voies, d’accepter l’inconfort de l’incertitude.
- Le collectif adaptatif est plus fort que l’individu isolé, mais il ne peut exister que si chaque singularité est reconnue et valorisée. C’est ce cercle vertueux que 1Clusif cherche à créer.
- La transmission des apprentissages est vitale. Nous ne pouvons nous permettre de réinventer la roue à chaque génération. Documenter nos expériences, partager nos échecs autant que nos réussites, construire une mémoire collective est un impératif de survie.
Augmenter notre coefficient d’adaptation collectif
L’histoire de l’adaptation à travers les âges n’est pas qu’un exercice académique. C’est un miroir tendu à nos organisations contemporaines. Les Vikings du Groenland et les habitants de l’île de Pâques ne sont pas des curiosités du passé : ce sont des avertissements. Le Japon Meiji et les sociétés qui ont su anticiper leurs crises écologiques ne sont pas des exceptions miraculeuses : ce sont des modèles dont nous pouvons nous inspirer.
Le défi qui nous attend – construire des organisations adaptables dans un monde en mutation accélérée – n’est pas nouveau dans sa nature. Ce qui est nouveau, c’est son urgence et son échelle. Nous ne pouvons plus nous permettre les lents apprentissages par tâtonnements qui ont permis aux sociétés passées d’évoluer sur plusieurs siècles.
C’est pourquoi augmenter notre coefficient d’adaptation collectif n’est pas un luxe, mais une nécessité existentielle. Cela passe par :
- Créer des espaces d’expérimentation où l’échec n’est pas sanctionné mais devient source d’apprentissage
- Favoriser la diversité des perspectives et faire confiance à l’intelligence collective plutôt qu’aux solutions imposées d’en haut
- Valoriser chaque singularité tout en construisant un collectif fort et cohérent
- Transmettre systématiquement nos apprentissages pour créer une mémoire organisationnelle vivante
- Accepter que l’adaptation ne soit pas linéaire ni prévisible, mais itérative et émergente
Les sociétés qui ont survécu aux grandes transitions n’étaient pas nécessairement les plus puissantes ni les mieux dotées. C’étaient celles qui ont su désacraliser leurs pratiques tout en préservant leurs valeurs, qui ont eu le courage de se remettre en question avant d’y être contraintes par la catastrophe, qui ont fait le pari de l’intelligence collective plutôt que de l’autorité rigide.
Chez 1Clusif, nous croyons que les entrepreneurs ont un rôle crucial à jouer dans cette grande adaptation contemporaine. Non pas en tant que héros solitaires, mais en tant que bâtisseurs de collectifs capables de transformer nos organisations et, à travers elles, nos territoires et notre société.
L’adaptation n’est pas un projet. C’est un processus permanent, une posture existentielle. Les civilisations qui l’ont compris ont traversé les millénaires. Les organisations qui le comprendront traverseront le siècle.
Rejoignez le mouvement 1Clusif
Vous êtes entrepreneur ou dirigeant d’entreprise ? Vous vous questionnez sur l’adaptation de votre organisation et la construction d’un collectif épanouissant ? Rejoignez 1Clusif pour échanger avec d’autres entrepreneurs engagés et passer à l’action.
Rédigé par Jérôme Savajols
