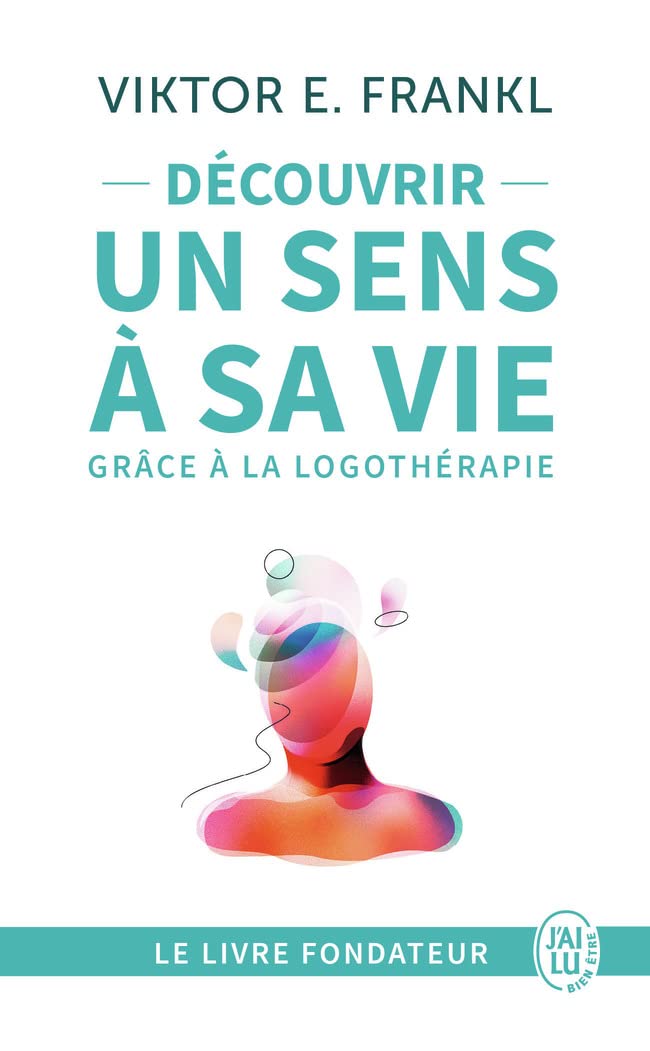Man’s Search for Meaning : Trouver un sens à sa vie face à l’adversité
Certains livres traversent les décennies sans prendre une ride. « Man’s Search for Meaning » (Découvrir un sens à sa vie avec la logothérapie) de Viktor Frankl fait partie de ces œuvres rares qui transforment profondément notre rapport à l’existence. Publié en 1946, ce témoignage poignant d’un psychiatre autrichien ayant survécu aux camps de concentration nazis dépasse largement le cadre historique pour nous interroger sur ce qui fait notre humanité : la quête de sens.
Viktor Frankl : Du camp de concentration à la logothérapie
Viktor Frankl n’était pas qu’un survivant. Psychiatre et neurologue viennois, il a traversé l’enfer d’Auschwitz et de plusieurs autres camps entre 1942 et 1945. Là où d’autres n’auraient vu que souffrance et déshumanisation, Frankl a observé, analysé, compris. Il a découvert que dans les conditions les plus extrêmes, ce n’était ni la force physique ni l’intelligence qui déterminaient la survie, mais la capacité à trouver un sens à sa souffrance.
Cette observation n’était pas théorique. Elle s’ancrait dans le quotidien du camp : ceux qui avaient une raison de survivre – retrouver un être cher, terminer une œuvre, témoigner – résistaient mieux psychologiquement que ceux qui avaient perdu tout espoir. Cette capacité à se projeter au-delà de l’instant présent, aussi terrible soit-il, constituait une forme d’adaptation cognitive et émotionnelle hors du commun.
La logothérapie : Quand le sens devient thérapeutique
De cette expérience extrême, Frankl a développé la logothérapie, une approche psychothérapeutique centrée sur la recherche de sens. Contrairement aux théories freudiennes dominantes de l’époque qui plaçaient le plaisir au centre de la motivation humaine, Frankl affirmait que notre besoin fondamental est de trouver un sens à notre existence.
Sa thèse est radicale et libératrice : nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive, mais nous gardons toujours la liberté de choisir notre attitude face aux événements. Cette liberté intérieure, que même les conditions concentrationnaires ne pouvaient pas retirer, constitue notre ultime dignité humaine.
Cette approche résonne particulièrement avec les défis contemporains d’exclusion et de marginalisation. Que l’on soit exclu du monde professionnel pour des raisons d’âge, d’origine ou de compétences techniques, retrouver du sens dans sa trajectoire devient un levier puissant de résilience.
Trois chemins vers le sens
Frankl identifie trois voies possibles pour découvrir un sens à sa vie :
Créer une œuvre ou accomplir une action – C’est le sens par la contribution. Que ce soit développer un projet numérique, transmettre des connaissances ou construire quelque chose qui nous dépasse, l’acte créatif donne une direction à notre existence. Dans un monde professionnel en mutation constante, cette dimension prend une importance capitale : notre valeur ne réside pas uniquement dans ce que nous savons aujourd’hui, mais dans notre capacité à créer et à contribuer demain.
Vivre quelque chose ou rencontrer quelqu’un – Le sens par l’expérience et la relation. Aimer, découvrir, s’émerveiller. Frankl rappelle que la beauté d’un coucher de soleil observé depuis les barbelés du camp pouvait, l’espace d’un instant, élever l’âme au-dessus de l’horreur quotidienne. La dimension sociale de notre existence n’est pas accessoire : elle est constitutive de notre humanité. C’est d’ailleurs ce que révèle la dimension sociale du Coefficient d’Adaptation, cette capacité à collaborer et à s’ajuster dans des configurations changeantes.
Choisir notre attitude face à la souffrance inévitable – C’est peut-être le chemin le plus difficile, mais aussi le plus profond. Lorsque nous ne pouvons plus changer une situation, nous pouvons encore nous changer nous-mêmes. Face à une exclusion professionnelle, une reconversion forcée ou un échec entrepreneurial, nous conservons cette liberté fondamentale : transformer l’obstacle en opportunité d’évolution.
L’adaptation comme réponse à l’absurde
La philosophie de Frankl dialogue intimement avec les enjeux d’adaptabilité qui définissent notre époque. Son expérience concentrationnaire illustre de manière extrême ce que signifie vraiment s’adapter : non pas simplement survivre, mais préserver son humanité dans des conditions qui visaient précisément à la détruire.
Cette forme d’adaptation dépasse largement la simple flexibilité comportementale. Elle mobilise quatre dimensions interconnectées :
La dimension cognitive d’abord : Frankl devait constamment réévaluer sa situation, désapprendre les certitudes de son ancienne vie, accepter l’impermanence radicale de son quotidien. Cette plasticité mentale, cette capacité à apprendre et désapprendre en permanence, constitue aujourd’hui une compétence vitale dans un monde professionnel où les métiers se transforment à une vitesse inédite.
La dimension comportementale ensuite : ajuster ses actions, expérimenter de nouvelles façons de survivre, abandonner les habitudes devenues obsolètes. Dans le camp comme dans nos organisations, la rigidité tue. Seuls ceux qui acceptent de modifier leurs pratiques face aux changements environnementaux peuvent prospérer.
La dimension émotionnelle surtout : maintenir un équilibre psychologique malgré l’horreur, cultiver l’espoir malgré l’absurde, rebondir après chaque humiliation. Cette résilience émotionnelle que Frankl décrit n’est pas un déni de la réalité, mais une acceptation lucide de ce qui est, couplée à un refus de se laisser définir par les circonstances.
La dimension sociale enfin : continuer à voir l’humain en l’autre, maintenir des relations authentiques malgré la déshumanisation systématique, comprendre que notre survie dépend aussi de notre capacité à créer du lien. Cette dimension relationnelle de l’adaptation demeure cruciale dans nos organisations modernes, où la collaboration et l’intelligence collective font souvent la différence entre échec et réussite.
Quand l’exclusion révèle le sens
Il y a quelque chose de paradoxal et de profondément instructif dans le témoignage de Frankl : c’est précisément dans la situation d’exclusion absolue – retrait de tous les droits, de toute dignité sociale, de toute appartenance – qu’il a découvert l’essentiel. Non pas malgré l’exclusion, mais à travers elle.
Cette leçon résonne différemment selon notre position. Pour ceux qui font l’expérience de l’exclusion professionnelle, sociale ou technologique, le message de Frankl n’est pas de romantiser la souffrance, mais de reconnaître qu’elle peut devenir un lieu de transformation. L’exclusion du marché du travail traditionnel peut devenir une opportunité de réinvention professionnelle, notamment dans les métiers du numérique et du code qui offrent de nouvelles portes d’entrée.
Pour ceux qui construisent des organisations et accompagnent des transitions, Frankl nous rappelle que notre rôle n’est pas de protéger les personnes de toute difficulté, mais de les aider à trouver du sens dans leurs défis. La transmission ne consiste pas à transférer des connaissances techniques uniquement, mais à accompagner la quête de sens qui rend ces connaissances utiles et désirables.
Un livre pour aujourd’hui
Pourquoi lire Frankl en 2025 ? Parce que notre époque génère ses propres formes d’absurde : l’accélération technologique qui rend nos compétences obsolètes avant même que nous les maîtrisions, les crises qui se succèdent sans nous laisser le temps de digérer la précédente, les transformations organisationnelles permanentes qui épuisent nos repères.
Dans ce contexte d’incertitude structurelle, « Man’s Search for Meaning » n’offre pas de réponses toutes faites. Il propose quelque chose de plus précieux : un cadre pour penser notre rapport au changement et à l’adversité. Il nous rappelle que l’adaptation authentique n’est pas une capitulation devant les circonstances, mais une affirmation de notre liberté intérieure.
Le livre nous confronte aussi à une question inconfortable : et si nous avions plus de liberté que nous le pensons ? Et si, au-delà des contraintes réelles – financières, professionnelles, sociales – nous conservions toujours cette marge de manœuvre que Frankl a identifiée dans les pires conditions imaginables : le choix de notre attitude ?
L’authenticité de Frankl
Ce qui rend le témoignage de Frankl si puissant, c’est précisément son refus du discours lisse. Il ne prétend pas que trouver un sens rend la souffrance agréable ou que l’attitude positive suffit à surmonter tous les obstacles. Il décrit aussi ses moments de doute, sa fatigue existentielle, ses tentations du désespoir.
Cette authenticité radicale nous protège d’une dérive courante dans la littérature de développement personnel : celle qui transforme l’adaptation en injonction positive, qui fait peser sur l’individu la responsabilité totale de son malheur. Frankl nous dit autre chose : oui, nous avons une responsabilité dans notre attitude, mais non, cela ne nie pas la réalité des systèmes d’oppression et d’exclusion.
C’est peut-être là que réside la plus grande leçon pour ceux qui œuvrent à réduire les exclusions : l’autonomisation des personnes ne signifie pas les laisser seules face à leurs difficultés, mais leur donner les ressources – matérielles, techniques, relationnelles – pour qu’elles puissent exercer cette liberté intérieure dont parle Frankl.
Construire du sens collectif
Si Frankl se concentre sur l’expérience individuelle de la quête de sens, son message a des implications collectives puissantes. Comment créer des organisations où chacun peut trouver du sens dans sa contribution ? Comment construire une culture de transmission qui ne se limite pas au transfert de compétences techniques, mais qui aide aussi à clarifier le « pourquoi » ?
Ces questions touchent au cœur de la construction d’organisations adaptables. Une entreprise où les collaborateurs comprennent le sens de leur action, où ils peuvent voir comment leur travail s’inscrit dans un projet qui les dépasse, développe une résilience collective bien supérieure à celle d’une organisation qui ne mobilise que par la contrainte ou la récompense financière.
C’est d’ailleurs ce que recherchent les pratiques de co-développement et d’intelligence collective : non pas simplement optimiser les processus, mais créer les conditions d’une quête de sens partagée. Quand les équipes expérimentent ensemble, apprennent de leurs échecs collectifs et célèbrent leurs victoires communes, elles ne font pas que s’adapter aux changements – elles trouvent un sens dans le processus d’adaptation lui-même.
Trois questions pour commencer
Plutôt que de résumer platement les enseignements du livre, Frankl nous invite à nous poser des questions essentielles. En voici trois pour entamer votre propre réflexion :
Quelle est la question à laquelle votre vie répond ? Frankl inverse la perspective habituelle : ce n’est pas nous qui questionnons la vie, c’est la vie qui nous questionne. Chaque jour, chaque situation nous demande : quelle est ta réponse ? Quelle contribution unique peux-tu apporter ?
Qu’est-ce qui vous rendrait capable de supporter presque n’importe quoi ? C’est la version frankienne du célèbre aphorisme de Nietzsche : « Celui qui a un pourquoi pour vivre peut supporter presque n’importe quel comment. » Qu’est-ce qui, pour vous, justifierait les efforts, les doutes, les obstacles ?
Si vous ne pouviez pas changer votre situation actuelle, que pourriez-vous changer en vous-même ? Cette question n’est pas une invitation à la résignation, mais à l’exploration de notre marge de liberté réelle. Elle nous ramène à cette zone où nous avons toujours du pouvoir : notre attitude, notre interprétation, notre réponse émotionnelle.
Un héritage vivant
« Man’s Search for Meaning » n’est pas qu’un témoignage historique ou un traité de psychologie. C’est un manuel de survie existentielle pour notre époque incertaine. À l’heure où l’intelligence artificielle bouscule nos métiers, où les crises se multiplient, où les parcours linéaires n’existent plus, Frankl nous rappelle une vérité libératrice : nous sommes plus grands que nos circonstances.
Cette lecture s’adresse particulièrement à ceux qui traversent des transitions difficiles, qui expérimentent l’exclusion sous une forme ou une autre, qui se demandent comment continuer quand les repères s’effondrent. Mais elle parle aussi aux entrepreneurs, aux managers, à tous ceux qui construisent des collectifs : votre rôle n’est pas seulement de créer de la performance, mais d’aider chacun à trouver du sens dans sa contribution.
Car au fond, c’est peut-être cela, l’inclusion véritable : pas simplement ouvrir des portes, mais créer les conditions pour que chacun puisse répondre à sa manière à cette question universelle que pose la vie : quel sens veux-tu donner à ton existence ?
Pour aller plus loin dans votre réflexion sur l’adaptation et la quête de sens, découvrez nos autres lectures qui explorent ces thématiques essentielles.
Rédigé par Jérôme Savajols